Valérie Anne Brouillard sur le rôle de la réglementation dans la transition énergétique du Québec
La réglementation est au cœur du défi climatique, particulièrement dans les grands centre urbains. Les ingénieurs Canadiens œuvrent à réduire durablement les émissions des bâtiments sur tous les fronts. Pour certains, la réglementation reste le meilleur moyen de soutenir la transition énergétique. C’est le cas Valérie Anne Brouillard, une ingénieure spécialisé en efficacité énergétique et décarbonation. Dans ce numéro de Demandez à l’expert, elle nous en dit plus sur l’importance des investissements en bâtiment durable pour l’économie du Québec, de la réglementation et des systèmes de performance environnementale.
Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours et de votre poste actuel ?
J’ai commencé ma carrière comme consultante en règlementation environnementale ou je me suis spécialisée en vérification de conformité environnementale et en calculs des émissions atmosphériques et de GES pour différentes compagnies industrielles au Québec et au Canada. En 2016, je suis arrivée à la Ville de Montréal à titre d’ingénieure en environnement et en changements climatiques. Pendant les trois premières années, j’ai travaillé principalement aux inventaires des émissions de GES de la collectivité montréalaise et des activités municipales ainsi qu’à la quantification des émissions de GES de certains grands projets municipaux. Le Bureau de la transition écologique et de la résilience a été créé en 2019 avec comme objectif à court terme de développer un Plan climat pour la Ville de Montréal. Pendant les 5 ans où j’y ai travaillé, j’étais responsable des mesures en réduction des émissions de GES du secteur immobilier montréalais du Plan climat Montréal 2020-2030.

Depuis septembre 2024, j’occupe le poste d’ingénieure séniore en stratégies d’efficacité énergétique et en décarbonation pour le secteur du bâtiment à la direction générale de l’expertise en transition climatique et énergétique du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec (ministère de l’Environnement). Je travaille à la mise en œuvre de la Loi sur la performance environnementale des bâtiments sanctionnée en mars 2024, entre autres, au déploiement du Système de déclaration, de cotation et de performance environnementale des bâtiments existants, aussi connu par son acronyme anglais BPS (Building performance standard). Je travaille en parallèle à développer un système d’analyse comparative spécifique pour le secteur des petits bâtiments résidentiels et commerciaux.
Quel a été votre rôle dans le développement de la feuille de route sur la décarbonation des bâtiments au sein du bureau de la transition écologique et de la résilience de la ville de Montréal? Pouvez-vous nous expliquer son importance ?
La Feuille de route vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040, présentée lors du Sommet climat Montréal 2022, vient préciser les mesures règlementaires du Plan climat Montréal pour la réduction des émissions de GES du secteur immobilier. J’ai participé activement à son élaboration et à la préparation de la consultation publique puis j’ai été nommée responsable du suivi de sa mise en œuvre.
De cette feuille de route du bâtiment découlent deux règlements des plus novateurs en transition énergétique et en décarbonation de la Ville de Montréal, de la province et même du Canada : le Règlement sur les émissions de GES des nouveaux bâtiments qui vient interdire l’installation d’appareil de chauffage à combustion dans les nouveaux bâtiments; et le Règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES des grands bâtiments qui jette les bases d’un BPS municipal. L’adoption par le conseil municipal de ces deux règlements et la réception positive des parties prenantes, incluant les deux distributeurs énergétiques, démontre la grande adresse dont la Ville a su faire preuve afin d’arriver à un résultat unanime tout en respectant ses engagements. La réalisation de la Feuille de route vers des bâtiments zéro émission fait de Montréal un leader de la transition écologique au Canada.
Investir dans des bâtiments durables est une des priorités pour l’atteinte des engagements climatiques du Québec. Quels sont les bénéfices d’avoir des bâtiments plus performants pour l’économie du Québec ?
En 2022, le secteur du bâtiment (résidentiel, commercial et institutionnel) était à l’origine de 7,6 Mt éq. CO2, soit 9,5 pour cent du total québécois, principalement à cause des besoins en chauffage. Les émissions du secteur ont diminué en raison d’une plus faible consommation des produits pétroliers utilisés pour le chauffage, et ce principalement dans le résidentiel. Le secteur consomme toutefois 33 pour cent de l’énergie totale du Québec. Entre 1990 et 2022, malgré une amélioration de l’intensité énergétique, la consommation a augmenté de 13 pour cent dans le résidentiel et de 69 pour cent dans le commercial et institutionnel (État de l’énergie au Québec, édition 2025).
Un potentiel notable de réduction de ces émissions de GES réside dans la diminution des pertes énergétiques. Le Plan pour une économie verte 2030 faisait déjà mention lors de sa publication en 2020 des efforts accrus à déployer en efficacité énergétique et pour une meilleure gestion de la pointe.
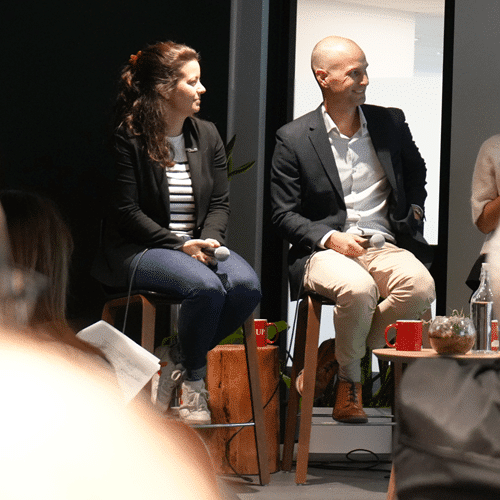
Dans le cas des bâtiments alimentés à l’électricité, cette meilleure gestion permettra de libérer de l’énergie et de dégager une marge de manœuvre pour électrifier davantage ou permettre que cette énergie serve à d’autres finalités. Alors que dans le cas de bâtiments alimentés aux énergies fossiles, les actions d’efficacité énergétique réduiront directement les émissions de GES. Dans tous les cas, les bâtiments durables faisant une meilleure gestion de l’énergie consommée se traduiront par des économies sur la facture énergétique pour ses propriétaires et locataires.
Ces bâtiments sont également amenés à prendre de la valeur au courant des prochaines années dans la mesure où un système de performance environnementale sera mis en place par le gouvernement. En effet, en amenant les propriétaires à se comparer et en fixant des cotes aux bâtiments, les bâtiments les plus performants vont se démarquer et vont avoir un net avantage sur le marché immobilier.
Investir dans l’efficacité énergétique est payant, non seulement pour le propriétaire, mais également pour toute la société civile. Comme mentionné, les blocs d’énergie libérés du réseau de distribution d’Hydro-Québec, par la réduction de la demande d’énergie nécessaire pour chauffer, climatiser et éclairer nos bâtiments pourront ensuite être réutilisés à d’autres fins, par exemple,
- électrifier d’autres secteurs d’activités tels que les transports ;
- allouer à des projets industriels au Québec qui génèrent des emplois;
- exporter vers les autres provinces ou les États-Unis, engendrant un plus grand profit pour Hydro-Québec et la société québécoise.
D’ailleurs à cet effet, dans le contexte de décarbonation et d’électrification des activités du Québec, Hydro-Québec estime qu’elle aura besoin de 60 TWh (ou 9 000 MW) supplémentaires d’ici 2035 pour décarboner le Québec. Si l’on veut limiter l’ampleur des nouveaux projets d’installations hydroélectriques ou d’immenses parcs éoliens ou solaires, les bâtiments durables et l’efficacité énergétique doivent être au cœur de la solution. Hydro-Québec entend miser davantage sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments, afin de dégager plus de 3 500 MW du réseau. On n’a pas fini d’entendre parler des bâtiments durables !
Comment le gouvernement peut-il ouvrir la voie et comment soutient-il les gestionnaires et les entreprises directement impliquées ? Quel est le rôle du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ?
Le rôle du ministère de l’Environnement est d’éviter et de réduire les émissions de GES dans l’objectif d’atténuer les conséquences environnementales, économiques et sociales des changements climatiques. Il est également responsable de soutenir la transition énergétique, de même que de favoriser l’adaptation aux changements climatiques. Pour ce faire, le ministère a mis en place une politique-cadre (Plan pour une économie verte 2030 – PEV) qui vient définir les mesures à mettre en place dans tous les secteurs d’activités pour parvenir à nos fins.
Une panoplie de mesures et de programmes sont mis en place par le ministère pour favoriser le développement des bâtiments durables et de l’efficacité énergétique dans les bâtiments. À titre d’exemples, le programme Rénoclimat guide les propriétaires dans leurs travaux de rénovation résidentielle pour améliorer la performance énergétique de leur bâtiment, notamment en bénéficiant d’un service-conseil d’un professionnel à domicile, et d’une aide financière pour effectuer des travaux d’isolation, d’étanchéité, de remplacement des portes et fenêtres, alors que le programme LogisVert d’Hydro-Québec offre un soutien financier pour l’acquisition d’une thermopompe. Par ailleurs, en ce qui a trait au programme Éconologis, les seuils de revenus admissibles ont été rehaussés.
Le financement des programmes Chauffez vert (résidentiel) et ÉcoPerformance (commercial, institutionnel et plus) se poursuit afin de soutenir les propriétaires de résidences et les entreprises qui souhaitent passer d’un chauffage fonctionnant à 100 % au gaz naturel à un système de chauffage fonctionnant majoritairement à l’électricité, ou convertir des systèmes de chauffage au mazout en systèmes fonctionnant à l’énergie renouvelable. Le programme ÉcoPerformance offre également une subvention pour des projets d’analyse des mesures d’efficacité énergétique, une remise au point des systèmes mécaniques, la mise en place d’un système de gestion de l’énergie, l’installation de système de réfrigération au CO2 dans les épiceries ou les dépanneurs et l’implantation de projet d’efficacité énergétique pour les grands émetteurs assujettis au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) et aux adhérents volontaires.
Finalement, le programme Bioénergie est un programme d’aide financière pour analyser ou implanter des projets de conversion à la bioénergie et réduire sa consommation d’énergie fossile.
Par ailleurs, le ministère a déjà annoncé bonifier sa règlementation pour encadrer le recours aux énergies fossiles dans les bâtiments et pour promouvoir une meilleure efficacité énergétique. À ce sujet, les actions suivantes sont inscrites au dernier Plan de mise en œuvre du PEV :
- Bonification du programme Valorisation des rejets thermiques et nouveau règlement rendant obligatoire la déclaration annuelle des données sur les rejets thermiques pour les industries assujetties ;
- Mettre en place un Système de performance environnementale des bâtiments en débutant par un règlement obligeant la déclaration des données de consommation d’énergie et des émissions de GES des bâtiments commerciaux, institutionnels et grands multilogements ;
- Pour les bâtiments qui ne seront pas visés par le Système, des travaux sont amorcés, en partenariat avec Hydro-Québec, dans le but d’informer les propriétaires de la performance énergétique de leurs résidences ;
- Rehaussement des normes de performance environnementale de tous les bâtiments, qu’il s’agisse de rénovations ou de nouvelles constructions.
Que pouvez-vous nous dire sur les solutions législatives, et en particulier celles découlant de la nouvelle Loi sur la performance environnementale des bâtiments ? Cela passe-t-il par une imposition graduelle de seuils de performance ?
Cette nouvelle loi permet de déterminer les renseignements relatifs à la performance environnementale des bâtiments qui doivent être déclarés. De plus, elle octroie au gouvernement le pouvoir d’attribuer une cote de performance environnementale aux bâtiments et de fixer, par règlement, des normes minimales de performance à respecter. Ces nouveaux pouvoirs constituent les principales assises juridiques pour mettre en place un système de performance environnementale des bâtiments. La loi permet du même coup l’élaboration de normes de performance environnementale en matière de travaux de construction.
Le système de performance environnementale des bâtiments se décline en quatre principaux volets, soit :
- La déclaration : ce volet consiste à exiger d’un propriétaire de bâtiment assujetti qu’il communique au ministre certains renseignements, dont la consommation énergétique du bâtiment et ses principales caractéristiques physiques. Cette déclaration amène automatiquement une prise de conscience du propriétaire.
- La cotation : ce volet consiste, à partir des données déclarées, à calculer et à attribuer une cote qui évalue la performance environnementale du bâtiment. Celle-ci permet de faciliter la comparaison entre bâtiments de même type.
- L’affichage public : ce volet consiste à rendre publiques une partie des informations déclarées et, dans certains cas, la cote attribuée, afin d’informer la population, dont les professionnels, les chercheurs et les citoyens en général.
- Les normes minimales de performance : ce volet constitue la pierre angulaire du système, puisqu’il amène le propriétaire à améliorer la cote attribuée à son bâtiment, de façon à respecter des normes minimales en matière de performance environnementale, notamment à l’égard de la consommation énergétique et des émissions de GES.
L’instauration de ce système a été identifiée dans le Plan de mise en œuvre 2024-2025 du Plan pour une économie verte 2030 comme une mesure phare pour permettre aux propriétaires de bâtiments de contribuer activement à l’atteinte des cibles gouvernementales de réduction des émissions de GES. De plus, l’information collectée par ce système permettra au ministère de l’Environnement d’alimenter ses travaux dans le secteur des bâtiments.